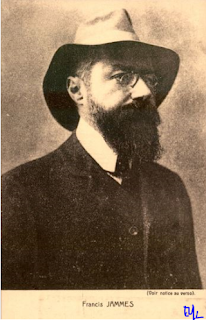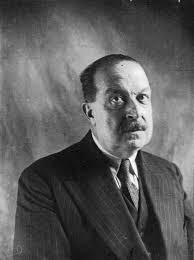ANDRÉ LICHTENBERGER ET LE PAYS BASQUE EN 1932.
Emile André Lichtenberger est un historien spécialiste du socialisme, un essayiste et romancier français.
Elève au lycée de Bayonne, il restera toujours attaché au Pays Basque sur lequel il a écrit plusieurs livres.
Voici ce que rapporta André Lichtenberger à ce sujet dans le Bulletin du Musée Basque, en 1932 :
"Pourquoi j'aime le Pays Basque.
Pourquoi j'aime le pays basque ? N'attendez pas, dans les lignes qui suivent, une analyse, après tant d'autres, de son charme. Depuis Loti le délicieux, combien de fois n'a-t-elle été esquissée ! Je n'en sais point qui, parmi ceux qu'il a séduits, en ait saisi le réel secret.
Aussi me bornerai-je à évoquer ici, en toute simplicité, quelques images qui demeurent inscrites en moi avec cette fraîcheur, cette ingénuité qui sont le propre des impressions d'enfance.
Le Jongleur de Notre-Dame trouva son salut en exécutant modestement ses tours devant la statue de la Vierge. Peut-être qu'une imagerie d'Epinal, dénuée de prétention, est le meilleur ex-voto que je puisse offrir au vieux terroir où s'essayèrent mes premiers pas et où j'irai dormir.
 |
| LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME PAR JULES MASSENET |
Le 13 juin 1872, arrivaient à Saint-Jean-de-Luz, un jeune couple alsacien, en deuil, et deux enfants. Ils s'y réfugiaient dans un douloureux désarroi physique et moral. Aux malheurs publics s'ajoutaient les deuils privés les plus cruels. Les quatre grands-parents enlevés en deux ans. Les santés gravement compromises, et profondément troublées les consciences. En même temps que saignaient les cœurs, l'angoisse les torturait : le devoir commandait-il de quitter l'Alsace pour rester fidèle à la France, ou, au contraire, d'y demeurer pour en disputer l'âme à l'envahisseur ?
Combien, dans ces pénibles conjonctures, cette région de notre Sud-Ouest se montra accueillante aux visiteurs endoloris qu'un enchaînement de circonstances bien imprévues lui amenait !
Du côté du Goulet, la vieille maison d'Abzac (aujourd'hui rajeunie sous le nom de Villa Sido) leur fut louée mille francs pour trois mois. Le petit pont qui la reliait à la plage mettait la mer caressante autant dire dans l'antichambre.
A cette époque, l'allure de la vie était moins trépidante que de nos jours. On eût cru la gaspiller à ne point tenir registre de ses moindres péripéties. J'ai sous les yeux le journal quotidien que tenait mon père, les copies des lettres qu'il adressait à sa famille et à ses amis : dans toutes ces pages, couvertes d'une nette et minutieuse écriture, vibre l'enthousiasme, la reconnaissance pour la terre bénie où, quelques semaines durant, le cauchemar cessa de traquer les fugitifs ; où les splendeurs du golfe de Gascogne et des Pyrénées dissipaient les sinistres visions obsédantes ; où un malheureux petit André oubliait par hasard d'avoir des bronchites.
Un jour avec sa nourrice une bourrasque du Sud-Ouest faillit l'enlever. On les raccrocha je ne sais trop comment. A l'automne les errants s'en allèrent, emportant un lumineux souvenir.
Cinq ans plus tard, veuve prématurément, la jeune femme revenait demander un abri à la contrée hospitalière qui était demeurée dans sa mémoire une oasis ensoleillée et saline. A ce petit André, obstinément fluet et pâlot, à une fillette encore plus fragile que lui, les grisailles du Nord étaient décidément trop inclémentes. Peut-être que seules les fées de la côte de Biscaye les aideraient à vivre.
De nouveau, la maison d'Abzac reçut les revenants. Et sur le sable, parmi les débris des maisons englouties un demi-siècle plus tôt par l'avance furieuse de la mer, l'enfant découvrit un après-midi dont l'émoi vibre encore en moi cette chose formidable : l'océan. Tout de suite il lui fut amical et l'éblouit de ses trésors : pierres précieuses longuement cherchées, si brillantes dans l'humidité marine et si vite ternies comme tant de joies quand on les étreint ; coquilles rares et fragiles comme tant d'espérances ; châteaux de sable éphémères, comme tant d'entreprises auxquelles il s'attacha.
 |
| PORT DE SAINT-JEAN-DE-LUZ PAR J CALAME BMB N°4 1932 |
C'est sur la plage de Saint-Jean-de-Luz que se découvrirent au petit bonhomme des horizons infinis et qu'il conçut de sublimes ambitions. D'une montagne de sable laborieusement élevée, combien de fois il essaya, précurseur de Wright, de s'envoler ! Et combien de trous furent creusés pour trouver le chemin qui mènerait au centre de la terre !
Ici, le mystère des eaux marines lui fut révélé. Dans son seau de fer blanc, il enferma les créatures fantastiques découvertes par le capitaine Nemo. Un jour, émule du kraken légendaire, un poulpe capturé par un grand cousin épanouit son horreur et ses tentacules dans la baignoire de la petite sœur.
 |
| CAPITAINE NEMO DANS VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS DE JULES VERNE |
Dans les nuits d'hiver (à cette époque l'Artha inachevée était une barrière impuissante) la mer furieuse montait parfois jusqu'à la jetée, et des flocons d'écume s'abattaient contre les vitres de la cuisine. Comme le vent hurlait et avec quelles menaces !
Au matin, il arrivait que la grève fût jonchée de débris. Un navire devant Ciboure avait été arraché de ses ancres. Avec quelle angoisse, on haletait à ouïr les étapes du laborieux sauvetage !
Et puis le ciel se nettoyait. En quelques instants renaissait le soleil : "Tu peux sortir sur la plage, André". Alors, il s'en allait, seul en apparence, mais en réalité environné de quelle compagnie merveilleuse : les héros d'Homère et ceux de Jules Verne, ceux de notre bon La Fontaine et de Madame de Ségur gambadaient avec lui sur le sable depuis le goulet de Ciboure jusqu'à la pointe Sainte-Barbe.
La Roche aux Mouettes, le Capitaine de quinze ans, les Aventures de Robert Robert, lectures magiques dont toutes les péripéties s'animaient de quelle vie ardente parmi ces émouvantes errances. Pourquoi ne pas le dire ? Ces compagnons-là étaient ceux d'élection, les plus fidèles, qui ne vous manquent jamais. Mais il n'est que juste de noter que l'été en ramenait d'autres.
 |
| LIVRE LA ROCHE AUX MOUETTES DE JULES SANDEAU 1871 |