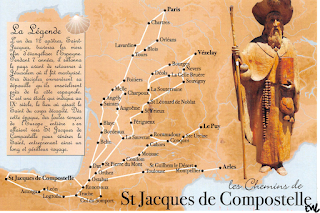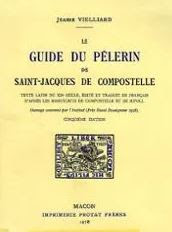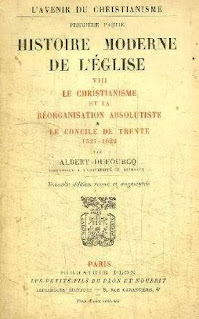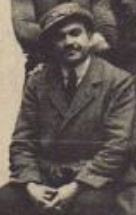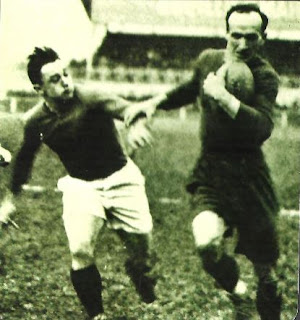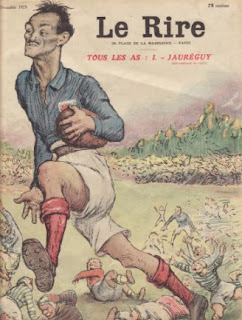LE CHÂTEAU D'OSTABAT.
Le château de Latsaga ou château de Laxague a été construit dans la seconde moitié du 14ème siècle à Ostabat, par extension d'une maison forte du 13ème siècle pour Pes de Laxague.
 |
| CHÂTEAU DE LATSAGA OSTABAT Par Utolotu — Travail personnel, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94148495 |
Je vous ai déjà présenté les châteaux suivants : Urtubie (Urrugne), Arcangues, Maytie (Mauléon),
Bidache, Haïtze (Ustaritz), Beraün (Saint-Jean-de-Luz), Artigaux (Moncayolle), Lacarre,
Irumberry (Saint-Jean-le-Vieux), Ahetzia (Ordiarp), Ruthie (Aussurucq), Cheraute, Ahaxe,
Charritte, Menditte, Eliçabia (Trois-Villes), Elhorriaga (Ciboure), Larrea (Ispoure) Saint-Pée-
sur-Nivelle, Mouguerre, Mauléon, Sault (Hasparren), Jaureguia (Armendarits), Garro
(Mendionde), Beyrie sur Joyeuse, Etchauz (Saint-Etienne-de-Baïgorry), Luxe-Sumberraute,
et les châteaux sans histoire, voici aujourd'hui le château de Laxague à Ostabat.
 |
| CHÂTEAU DE LAXAGUE OSTABAT BMB N°6 1933 |
Voici ce que rapporta à ce sujet le Bulletin du Musée Basque N° 6 de 1933 :
"Château de Laxague, à Ostabat.
Le château de Laxague se trouve à un kilomètre au Sud du village d'Ostabat. Il est généralement peu connu, ce qui tient sans doute à sa situation. Au pied d'un côteau, entouré d'arbres, il n'est pas visible de loin et on peut passer près de lui sans se douter de son existence. Il présente cependant un réel intérêt au double point de vue archéologique et historique.
Malheureusement, les renseignements que l'on possède sur ses anciens propriétaires sont très incomplets et ne peuvent fournir qu'une très légère contribution à l'histoire du pays.
En 1270, il est fait mention de Pées de Laxague qui accompagna à la croisade les rois Saint-Louis et Thibaut II ; mais, plus heureux que son souverain, il en revint.
Ses descendants figurent à l'occasion des principaux événements qui marquèrent les siècles suivants, sans cependant avoir eu un rôle de premier plan. Par contre, par leurs alliances et leur politique, ils ont fait bonne figure à toutes les époques.
Cette famille atteignit l'apogée de sa fortune au 14ème siècle avec un autre Pées de Laxague. Pées avait épousé Jeanne de Beaumont, fille naturelle de Louis, infant de Navarre, troisième fils de Philippe III, roi de ce royaume. Il avait ainsi acquis des attaches puissantes et il sut les mettre à profit. Il était ricombre et jouissait de toutes les faveurs accessibles aux gentilshommes navarrais. Il est cité comme "señor del palacio de Larçaban", en 1388, dans le rôle des gentilshommes qui servent le roi avec armes et chevaux. Plus tard on le trouve chambellan du roi Charles III le Noble.
Au milieu des intrigues qui séparèrent les deux partis de Gramont et de Beaumont, il sut garder un juste milieu bien qu'il inclinât plutôt vers les Beaumontais. En 1384, il est cité comme assistant à une des nombreuses trêves au cours desquelles ces seigneurs jurèrent d'observer une paix qui ne dura pas plus que les précédentes. Vers la même époque, il rendit un signalé service à la cause royale dans les circonstances suivantes.
Il a été question, dans l'article relatif au château d'Urtubie, d'une expédition en Albanie à laquelle prirent part plusieurs gentilshommes basques. L'infant de Navarre en faisait partie.
Se trouvant là-bas dans une situation fort embarrassée, il pria Charles le Mauvais de lui envoyer du secours. Celui-ci s'adressa à Pées de Laxague et lui demanda de fournir à l'infant cent lances, mais en ajoutant qu'il n'était pas en situation d'en faire les frais.
Laxague prit 1 900 ducats qui formaient la dot de sa femme et emprunta à Bertrand de Lacarre 42 marcs d'argent. Puis il partit au secours de l'infant. Revenu en 1388, il reçut du roi de Navarre, pour prix du service rendu, "les droits de rente provenant du territoire d'Ostabaret avec le bailliage de ce pays et dans les terres de Soule, avec dix vaches et quatre saumons que les Souletins lui doivent payer tous les deux ans."
Dans une pièce de la même époque le seigneur de Laxague est désigné comme possédant aussi les pays de Labets, Somberraute, Irissary et Gentein. Il mourut en 1393 ne laissant qu'une fille. Ses titres, biens et nom passèrent à son petit-fils, Bertrand de Sainte-Engrâce, marié à Marie d'Echauz.
Bertrand, armé chevalier en 1396, reçut, en outre des charges héritées de son grand-père, celle de châtelain de Saint-Jean-Pied-de-Port qu'il remplit de 1397 à 1407.
Dans cet intervalle, il fut chargé, par le roi de Navarre, de plusieurs missions en Angleterre, ce qui montre de quelle considération il jouissait, non seulement auprès de Charles le Noble, mais aussi de la part de Jean d'Aragon. Ce dernier lui fit don, le 8 septembre 1431, de trois-cent-quatorze livres de rente sur les péages d'Ostabat et de Saint-Jean-Pied-de-Port en récompense de ses bons et nombreux services.
Le fils et le petit-fils de Bertrand bénéficièrent des mêmes bienveillances royales ; mais le roi exigea d'eux l'engagement de ne plus se mêler des querelles entre les Luxe et les Gramont. Cela ne porta pas bonheur au seigneur de Laxague, car une bande de partisans des Gramont le mit à mort, "sans nul motif et sans qu'il ait fait déplaisir ou dommage à homme du monde", est-il dit dans la plainte que sa mère adressa, à ce sujet, à Roger de Gramont.
Lors de la séparation de la Haute et de la Basse Navarre, son successeur resta fidèle à son souverain légitime Jean d'Albret et, lorsque Henri d'Albret succéda à son père, en 1520, il se rendit à Saint-Palais pour lui prêter serment de fidélité.
Bernard II, son fils, qui lui succéda dans toutes ses prérogatives, eut une conduite assez équivoque pendant les guerres de religion. Etant donné ses attaches avec les Luxe il est peu vraisemblable qu'il n'y prit aucune part. Quoi qu'il en soit il ne fut pas compris parmi les meneurs dont la conduite indisposa au plus haut point la reine et son fils. Il conserva la charge de bailli d'Ostabaret et il est probable qu'il ne perdit pas les bonnes grâces du roi, à en juger par la lettre qu'Henri IV écrivit plus tard à Sully à son sujet...
On voit que si les Laxague pouvaient être classés parmi les bonnes familles du pays, par leurs alliances et par les emplois qui leur étaient confiés, ils n'en étaient pas moins peu fortunés, partageant en cela le sort de la plupart des gentilshommes basques.

BLASON DE LA FAMILLE LAXAGUE