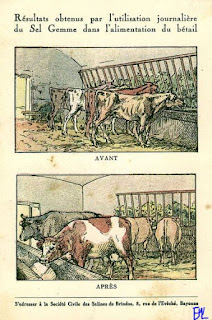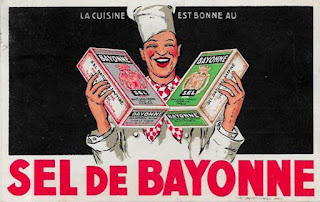MGR JEAN DE SAINT-PIERRE DE VILLEFRANQUE.
Jean Saint-Pierre (Anxuberro), né le 28 mars 1884 à Villefranque (Pyrénées Atlantiques) et mort le 18 décembre 1951 à Villefranque, est un prélat catholique, promoteur de la culture Basque, écrivain, académicien français de langue Basque, évêque auxiliaire de Carthage (Tunisie) de 1930 à 1937, et titulaire du titre d'évêque de Gordus de 1930 à 1951.
Voici ce que rapporta à son sujet le quotidien La Croix, le 3 juillet 1930 :
"Mgr Saint-Pierre auxiliaire de Carthage.
Dans une lettre pastorale, Mgr Gieure, évêque de Bayonne, annonce l'élévation de M. le chanoine Saint-Pierre à l'épiscopat et rapporte la carrière du nouvel élu. Nous donnons de longs extraits de ce bel hommage à l'auxiliaire de Mgr l'archevêque de Carthage.
 |
| MONSEIGNEUR FRANCOIS-XAVIER-MARIE-JULES GIEURE |
Mgr Jean Saint-Pierre est né à Villefranque (doyenné d'Ustaritz), le 28 mars 1884. Il est le huitième d'une famille qui compte dix enfants, parmi lesquels il faut signaler une religieuse, Soeur Blanche missionnaire d'Afrique, et un religieux Trappiste, au monastère de Divielle, dans les Landes. C'était une famille patriarcale. Le grand-père, poussé par son zèle chrétien, s'était fait catéchiste dans son quartier ; il mettait sa joie à apprendre aux enfants les premiers éléments de la religion. Lorsque, en 1886, on décida d'ouvrir une école chrétienne à Villefranque, le père fut le premier à s'inscrire comme ouvrier volontaire pour la construction d'un établissement scolaire. On n'était pas riche, et ce n'est qu'à force de travail et de privations qu'on arrivait à nourrir et à élever la nombreuse famille.
A ce foyer s'était conservée une touchante coutume autrefois religieusement observée dans les régions du pays basque, du Béarn et de la Gascogne. Quand arrivaient des mendiants de passage, ils s'installaient dans ces demeures hospitalières comme chez eux ; ils y trouvaient le gîte et le couvert, pas toujours l'abondance, mais le suffisant avec l'accueil cordial. Ces pauvres appelaient les bénédictions du ciel sur leurs hôtes.
A ce foyer modeste de Villefranque, la mère hébergeait ces mendiants de passage et, parfois, pour les loger, elle obligea ses propres enfants à céder leur place et à coucher sur la dure. Celui qui devait être évêque en a fait l'expérience.
Ces mendiants, l'Evangile les appelle des Christs de passage. "Quand vous avez donné à manger à un pauvre, quand vous lui avez donné à boire, quand vous l'avez recueilli sous votre toit, quand vous l'avez revêtu, c'est moi, le Christ, que vous avez ainsi traité ; quand vous avez fait cela à un seul de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait : mihi fecistis."
Et ici, le Christ a récompensé la mère hospitalière : deux religieux, un évêque avec, par surcroit, la promesse du royaume des cieux.
Jean a grandi ; le voilà enfant de choeur. Son curé, M. le chanoine Schloegel, le vicaire de la paroisse, M. Marty, aujourd'hui curé de Sare, ont remarqué la vivacité de son intelligence, son goût pour les choses d'Eglise. On lui donne des leçons de latin. A 12 ans, il entre au Petit Séminaire de Larressore...
Dès le début, le jeune Jean Saint-Pierre se révèle comme un élève brillant ; le succès le suit jusqu'au terme de ses classes. Son nom restera inscrit parmi les plus éminents dans cette pléiade de sujets qui, depuis plus de deux siècles, ont rendu célèbre le Petit Séminaire de Larressore et honoré le pays basque. Ce qui distingue le jeune élève, et est à sa louange, c'est qu'il mérita et obtint d'entrer en relations intimes et durables avec ce maître homme à la physionomie rude et au coeur d'or qu'était M. le chanoine Abbadie, son supérieur.
Au Grand Séminaire, ce sont les mêmes succès en philosophie et en théologie. Par sa régularité, par une faculté d'assimilation rare et un talent de parole qui s'affirme, l'abbé Saint-Pierre appelle sur lui l'attention de ses maîtres. On l'envoie à Toulouse pour prendre les grades littéraires ; un an après, il est licencié ès lettres. Il est ordonné prêtre en 1908, puis envoyé à Rome. Il rentre à Bayonne en 1910 ; il est docteur en théologie. Ses études sont terminées, brillamment terminées. La carrière sacerdotale s'ouvre devant lui et il arrive bien préparé, bien armé, pour toute sorte de ministères.
 |
| GRAND SEMINAIRE BAYONNE PAYS BASQUE D'ANTAN |
Il est nommé vicaire de Saint-André de Bayonne. Pendant deux ans, il déploie un zèle ardent dans les oeuvres de jeunesse. Le supérieur des missionnaires de Hasparren le demande, et pendant deux années encore il parcourt le pays basque et prêche avec succès des missions, des retraites. La chaire de théologie morale devient vacante au Grand Séminaire. Elle lui est offerte en février 1914 ; M. l'abbé Saint-Pierre se révèle comme un professeur émérite : son enseignement est méthodique, clair, subtil autant qu'il est requis, et bien vivant.
 |
| EGLISE ST-ANDRE BAYONNE PAYS BASQUE D'ANTAN |
La guerre éclate. Il est mobilisé le 2 août 1914. Il prend part à la retraite de Charleroi, aux batailles de Guise, de la Marne et de l'Aisne. Puis ce fut Verdun, la Somme, Craonne, Montdidier.
Mgr Gieure cite une lettre où Mgr Saint-Pierre raconte l'assaut donné le 4 mai 1917, au plateau de Craonne. Ce fut une attaque effroyable : les Basques bousculèrent la garde prussienne et occupèrent le plateau ; arrivé des tout premiers, l'abbé Saint-Pierre planta le drapeau du Sacré-Coeur sur la position que l'on disait inexpugnable et eut la joie de ramener son escouade au complet.
Le prêtre se retrouvait sous le soldat. En 1916, l'abbé Saint-Pierre seconde M. l'abbé Bergey qui, durant un mois, prêche à la 36e division et la prépare aux héroïques luttes sous Verdun.
En juin 1917, la terrible crise morale commençait à sévir dans quelques sections. Le commandant de la 36e division charge l'abbé Saint-Pierre de grouper les combattants basques, de les haranguer en leur langue, de leur rappeler le devoir rigoureux d'une discipline parfaite. L'état-major assistait à cette réunion.
Le 28 mars 1918, l'abbé Saint-Pierre est blessé dans la défense de Montdidier. Encerclé avec les débris de sa section qui a tenu 48 heures, accrochée aux avant-postes où elle avait reçu mission de se laisser anéantir, il est fait prisonnier. Il passe un mois à l'hôpital de Namur.
Le gouvernement allemand, sur la prière de Benoît XV, consent à ce que des séminaristes et scolastiques français prisonniers puissent continuer leurs études de théologie. Un Séminaire est ouvert dans un baraquement à Limbourg-en-Lahn et M. l'abbé Saint-Pierre est désigné comme professeur de théologie d'une centaine d'élèves. Détail touchant : ces étudiants ont envoyé à leur ancien maître leurs vives félicitations avec l'expression de leur gratitude.
 |
| PRISONNIERS CAMP DE LIMBOURG 1916 ALLEMAGNE D'ANTAN |
Lorsque, peu après, un religieux italien est désigné pour la même fonction auprès des séminaristes ses compatriotes, Benoît XV lui donne pour consigne de tout organiser comme chez les français.
La guerre terminée, M. l'abbé Saint-Pierre remonte dans sa chaire de théologie morale et poursuit ses leçons pendant 4 ans.
Le 8 novembre 1922, un secrétaire d'évêché est à nommer. Il fallait, en même temps, pourvoir à la direction de quelques oeuvres. M. l'abbé Saint-Pierre est nommé secrétaire de l'évêché de Bayonne et fait chanoine honoraire. Depuis ce jour, son activité va rayonner sur tous les points du diocèse. Avec un zèle qui ne calcule pas, il va se dévouer à un grand nombre de tâches. Par la plume, par la parole, par l'action, M. le chanoine Saint-Pierre sert la cause religieuse avec intelligence, avec courage, avec succès. Une facilité rare lui permet d'aborder tous les genres d'apostolat.
C'est ainsi qu'il est nommé directeur du Bulletin Religieux de Bayonne, directeur du journal Eskualduna. Il porte la bonne parole aux réunions de l'Union catholique ; il se fait le missionnaire des assurances sociales ; il organise les Syndicats féminins chrétiens de la couture et des employées bayonnaises ; il fonde le groupe basque Saint-François-Xavier de l'Union catholique des postes et le groupe de l'Union catholique des banques et assurances. Il est chargé de l'oeuvre des Vocations ; il prêche sans relâche des sermons de circonstance. Secrétaire général du Congrès eucharistique national, pendant 6 mois, il en prépare l'organisation minutieuse avec des Comités spéciaux qu'il dirige et dont il provoque et utilise le concours précieux.
M. le chanoine Saint-Pierre se dépensait joyeusement, menant de front, et avec une aisance parfaite, les besognes qui lui étaient confiées.
Dans l'intervalle, Mgr Lemaître, archevêque de Carthage, venait à Bayonne. Une première fois, le centenaire du cardinal Lavigerie l'attire et le retient auprès de nous. Mgr Lemaître est un charmeur et un conquérant ; il est de la lignée des grands évêques de France. Pour le revoir et jouir de lui encore, nous le prions de prêcher au clergé de Bayonne deux retraites pastorales ; il accepte ; nos relations se font plus intimes, toutes cordiales. Il vient au Congrès eucharistique national de Bayonne ; il voit à l'oeuvre notre clergé et s'éprend d'estime et d'affection pour lui. Pendant les 4 visites qu'il nous a faites, il regarde, il observe autour de lui alors que nous, sans défiance, lui livrions les clés de la maison. Sûrement, il a remarqué le jeune secrétaire de l'évêché de Bayonne...
 |
| MONSEIGNEUR ALEXIS LEMAÎTRE |
 |
| 7EME CONGRES EUCHARISTIQUE NATIONAL BAYONNE 3-7 JUILLET 1929 |
.jpg)