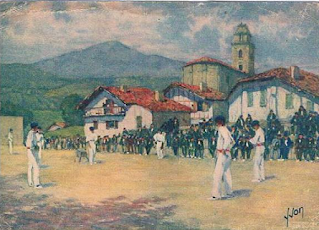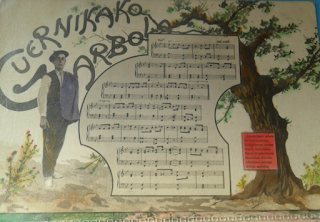LES JEUX DE PAUME ET LES TRINQUETS EN 1929.
Les jeux de paume ont existé en France, depuis plusieurs siècles.
Voici ce que rapporta à ce sujet le Bulletin du Musée Basque N° 12, en 1930, sous la plume
d'Albert de Luze :
"Les Jeux de Paume et les Trinquets.
Conférence donnée au Musée Basque le 28 Septembre 1929, avant la partie de démonstration qui mit aux prises le même jour, au vieux Trinquet Saint- André, M. E. Baerlein, champion amateur anglais et Pierre Etchebaster, champion du monde professionnel.
"... A côté de ses fins sportives, le jeu de paume a eu en France une bien curieuse influence, car pendant plus d'un siècle les grandes salles dans lesquelles il se jouait ont été utilisées comme salles de spectacle. Il n'y avait en effet, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, en dehors de la Capitale où encore elles étaient rares, aucune salle proprement dite où les troupes nomades qui parcouraient la France pouvaient donner leurs représentations et comme il y avait dans chaque petite ville un ou plusieurs Jeux de paume, ces salles donnèrent tout naturellement asile aux comédiens, d'autant plus facilement que pendant les mois d'hiver elles étaient inutilisables pour le jeu à partir de quatre heures de l'après-midi. On y installait alors des tréteaux, une scène rudimentaire, on y mettait des chaises ou des bancs et... l'art remplaçait le sport. Nous savons que Molière forcé de quitter Paris en 1648 fit avec "l'Illustre Théâtre" (troupe de Dufrène et des Béjart) une tournée en province qui dura dix ans. S'il y a ici des moliéristes ils apprendront peut-être avec intérêt, s'ils ne le savent déjà, que, pendant cette tournée, à part une ou deux exceptions, leur héros n'a joué la comédie que dans des Jeux de paume et on peut se demander vraiment ce qui serait advenu de l'illustre comédien s'ils n'avaient pas existé. Le moins qu'on puisse dire est qu'il eût été bien gêné. Rechercher quels furent les Jeux de paume qui donnèrent asile à la célèbre troupe m'a paru d'un certain intérêt et j'ai eu la bonne fortune de les retrouver presque tous. Je peux vous dire qu'à Paris, où Molière a débuté dans un jeu de paume en 1643, c'était le jeu des Métayers, puis le jeu de la Tête Noire ; à Nantes, le jeu du Chapeau Rouge ; à Poitiers, le jeu des Flageolles ; à Bordeaux, la salle Barbarin ; à Dijon, le jeu de la Poissonnerie ; à Rouen, le jeu des Braques (car la plupart des Jeux de paume portaient un nom ou une enseigne) et qu'à Agen, Narbonne, Pezenas, Avignon, Grenoble, Lyon, c'est également dans un Jeu de paume qu'il s'installa. Quand il mourut, la troupe chassée du Palais-Royal par Lulli trouva asile dans le Jeu de la Bouteille, quelques années auparavant transformé en salle d'opéra pour le florentin qui d'ailleurs n'y mena pas ses violons mais s'installa dans le jeu de Bequet, rue Vaugirard, rue dans laquelle il y avait cinq Jeux de paume côte à côte. A Bayonne, si l'on ne trouve pas trace du séjour de Molière, qui n'y est sans doute pas venu, on sait cependant que les deux Jeux de paume furent utilisés comme salles de spectacle. Dans son histoire du théâtre de Bayonne, l'inévitable et instructif Ducéré nous apprend que les écholiers donnaient leurs représentations dans le Jeu de paume de Niert ; ils dressaient un théâtre dont la scène reposait sur des tables et des barriques. Une supplique de Jacques Combe, du 16 Octobre 1694, nous dit "qu'une rixe fut causée par les billets de spectacles qu'il avait pour une tragédie que les élèves du collège devaient représenter ce jour-là au jeu de paume de M. de Niert" (ce qui nous prouve aussi que les deux Jeux ont co-existé pendant tout le XVIIe siècle). La reine douairière d'Espagne, Anne de Neubourg, assista à une de ces représentations, mais pour ne pas faire de jaloux sans doute, elle assista aussi aux représentations qui se donnaient dans le Jeu de paume de Maubec.
 |
| VIEUX TRINQUET BAYONNE 1930 BMB N°12 1930 |
Pendant toute la première moitié du XVIIIe siècle les troupes de comédiens nomades deviennent de plus en plus nombreuses. Sauteurs, voltigeurs, tragédies, drames, opéras, ballets, etc... nous voyons ces genres si divers se succéder presque sans interruption dans le Jeu de paume de Maubec alors transformé en salle de spectacle. "Le 20 Mai 1792, disent les archives de la ville, est venue en diette la demoiselle veuve de Meillan, laquelle aurait demandé la permission de laisser entrer dans le jeu de paume de Maubec qu'elle tient à loyer, les comédiens italiens pour y représenter leur pièce en public ce qui leur a été permis." Bayonne peut, je crois, se vanter d'avoir eu le dernier Jeu de paume utilisé comme théâtre.
Nous connaissons donc ainsi par les Jeux de paume la plupart des salles de spectacle du XVIIe siècle et Paul Souday qui avait pour le sport une aversion qui m'a toujours parue fort exagérée, et que ne partage certainement pas mon célèbre partenaire de tennis André Lichtenberger, Paul Souday, dis-je, aurait sans doute dû reconnaître que le sport avait malgré tout été pour l'art d'une certaine utilité. Mais là ne s'arrête pas l'influence du jeu de paume sur le théâtre. Dans les Sports et Jeux d'Exercice dans l'Ancienne France, M. Jusserand nous en montre un autre aspect :
"On s'habitua, dit-il, tellement à voir théâtre et jeu de paume se confondre, que très tard, par habitude, on conserva au premier la forme des seconds. Il est certain que partout ailleurs dès le XVIe siècle, en Italie et en Angleterre, la forme semi-circulaire avait prévalu... Nous fîmes exception, effet inattendu de l'extraordinaire popularité d'un jeu d'exercice en France."
 |
| LIVRE LES SPORTS ET JEUX D'EXERCICE DANS L'ANCIENNE FRANCE DE J. J. JUSSERAND |