L'ARMÉE FRANÇAISE AU PAYS BASQUE À LA FIN DU 18ÈME SIÈCLE.
La frontière, au Pays Basque, a, souvent, été le théâtre de manoeuvres militaires.
Voici ce que rapporta à ce sujet le quotidien Le Spectateur Militaire, dans plusieurs éditions, sous
la plume du Lieutenant-Colonel J. B. Dumas :
- le 1er mars 1909 :
"Couverture de la zone-frontière des Pyrénées.
Manœuvres de couverture du maréchal Soult en 1813.
 |
| MARECHAL JEAN-DE-DIEU SOULT |
Battue à Vitoria le 21 juin 1813, l’armée française se trouvait en juillet sur la frontière des Pyrénées, de Saint-Jean-Pied-de-Port à l’embouchure de la Bidassoa. Elle y contenait l’ennemi. Le maréchal Soult arrivait à Bayonne le 12 juillet pour prendre le commandement. Il disposait de 69 000 hommes. En face de lui, l’armée de Wellington comptait 90 000 hommes.
Dès la fin de juillet, le maréchal Soult prenait l’offensive par Saint-Jean-Pied-de-Port et par le col de Maya, afin de secourir Pampelune. Il parvenait à percer jusqu’à 10 kilomètres de Pampelune ; mais, après une lutte de deux jours, (28 et 29 juillet), il était rejeté en France, ayant perdu 13 000 hommes. (Sorauren.)
Le 31 août, il effectuait une nouvelle tentative pour délivrer Saint-Sébastien ; il était repoussé avec une perte de 3 600 hommes.
Wellington se trouvait alors à la tête de 131 000 hommes. Le 7 octobre, il prenait l’offensive, surprenait le passage de la Bidassoa et enlevait la Croix-des-Bouquets près de Saint-Jean-de-Luz, la Baïonnette en avant d’Ascain et la montagne de la Rhune.
Le 8 septembre, Saint-Sébastien, après une énergique défense et cinquante-neuf jours de tranchée ouverte, avait dû se rendre. Pampelune se rendait le 31 octobre après quatre mois de siège.
Le 10 novembre, Wellington reprenait l’offensive contre le maréchal Soult établi sur les deux rives de la Nivelle, de Saint-Jean-de-Luz à Urdax. Il forçait le centre français à Saint-Pé, après un combat acharné et repoussait le maréchal sous Bayonne.
 |
| DUC DE WELLINGTON |


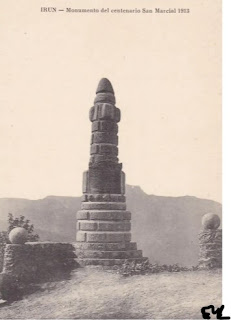





_by_Antoine-Claude_Fleury_(fl_circa_1790-1822).jpg)



